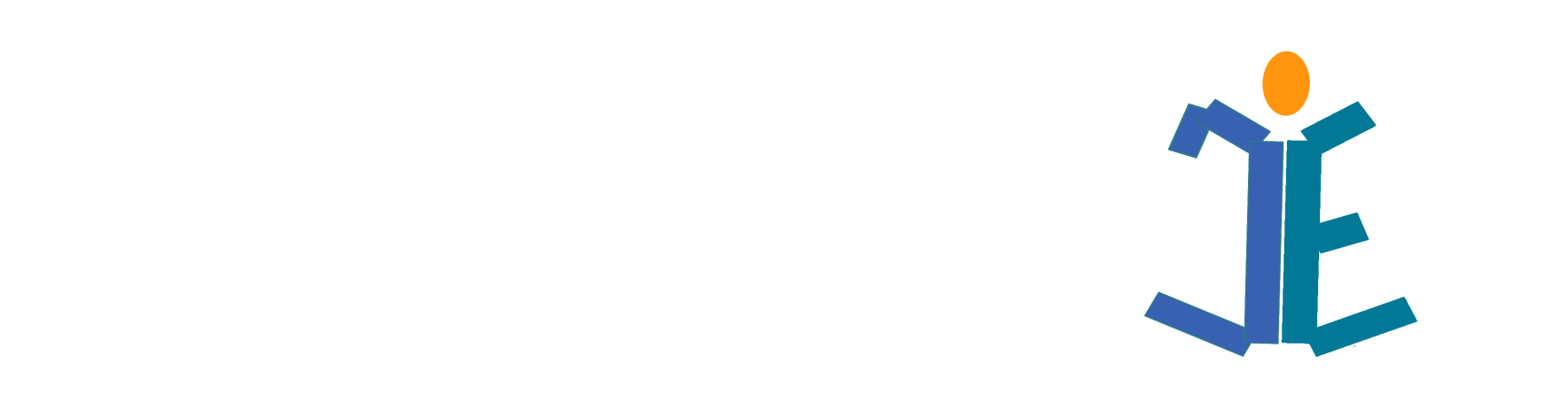Ce cours de français de 6ème n’est pas une poésie mais un terrain vague embroussaillé. Et une effigie.
Quand on n'est pas sourd-muet, on apprend à réciter oralement, pas par écrit. Pas un texte défiguré accompagné de consignes écrites muettes. Comme si l'oralité était devenue secondaire. En cours de langue ! Comme si l'adulte en face des jeunes n'avait plus la capacité ou la volonté de communiquer directement. Comme si l'acte pédagogique se résumait à être là et à donner un travail à faire. Pas plus que cet écrit n'est une poésie, ce travail n'est un acte pédagogique.

Voici les consignes de lecture :
- Traits rouges : liaisons.
- Les "e" colorés en rose se prononcent
- Les "e" barrés ne se prononcent pas.
Notons ces liaisons (faites-les à haute voix) :
"Vers les buissons-z-errent les lucioles"
"Par les joncs verts-z-où circule un frisson"
D’après ma petite fille, les élèves perdent des points s'ils ne font pas les liaisons...
Concernant la prononciation de "e" : ce n'est pas "e" qui ne se prononce pas mais la consonne qui le précède qui se prononce. Les élèves étant francophones, cette précision constitue une distraction/perturbation de leur attention car dans la vie de tous les jours, personne ne dit prairieu, corolleu, porteu ou crinièreu. Cette précision attire l'attention sur un problème inexistant. Ce qui revient à créer un problème pour rien ; sans raison pédagogique. Un problème insoluble puisqu'il ne se pose pas.
Pour des enfants qui ont des difficfultés à apprendre, à mémoriser, cette façon de procéder est un obstacle infranchissable. Le drame étant que les effets directs en termes d'apprentissage ne seront jamais rattachés à ce procédé. Quand des enfants montreront des signes manifestes de dispersion de l'attention, on parlera de syndromes et autres causes savantes. Quant à imaginer le nombre d'enfants possiblement affectés tout au long de leur scolarité...
Pourquoi je parle d'effigie ? Je vois dans ce texte plus une divinité en pierre qu'une poésie en harmonies. Enseveli sous une couche de technicité dépourvu de vibrations, ce texte inerte, atone, efface l'acte poétique/pédagogique transformant l’enseignant en prêtre... L'association d'idées vient toute seule : prêtre, foi, idôlatrie.
Dans cette représentation, l'enseignant occupe en définitive la place de la divinité car les enfants sont contraints à prendre pour vrai ce qui leur est donné. Et quand ils montrent une faiblesse de logique, d'expression, de pensée, de confiance en soi... ce sera attribué à des difficultés personnelles. Pas à un mode de transmission perturbant.
Dans le même ordre de réflexion, les comptines ne se chantent plus par des personnes réelles, en présence, mais sont écoutées sur les supports électroniques en l'absence d'un adulte. Et deviennent objet d'addiction/idôlatrie...
Illustrons les causes possibles de perturbations de l'attention/intuition avec cet exemple futile : pourquoi un conte mais une comptine...